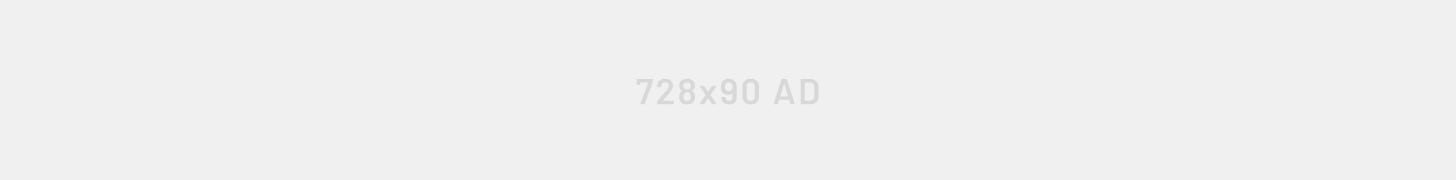Résumé
Les inondations à Dakar sont le résultat d’un enchevêtrement de facteurs historiques, environnementaux et socio-spatiaux. Leur compréhension exige de remonter à la genèse des formations lacustres de la presqu’île du Cap-Vert, à la sécheresse des années 1970 et à l’urbanisation rapide qui a suivi, marquée par un déficit de planification territoriale et d’assainissement. Cet article analyse les causes structurelles des inondations dans la région de Dakar, met en évidence les responsabilités institutionnelles et propose des solutions intégrées, en lien avec le Plan National d’Aménagement et de Développement Territorial (PNADT), le Programme des 100 000 logements, et la prospective Horizon 2050.
Introduction
L’agglomération dakaroise, qui concentre plus de 25 % de la population nationale sur moins de 0,3 % du territoire (ANSD, 2023), fait face à des inondations récurrentes qui affectent des centaines de milliers d’habitants. Ce phénomène n’est pas uniquement conjoncturel, mais le produit d’une combinaison de facteurs environnementaux, sociaux et politiques.
Dynamiques multifactorielles et diagnostic des inondations à Dakar
Les inondations récurrentes à Dakar trouvent leur origine dans un ensemble de facteurs interdépendants qui dépassent la seule dimension climatique. Elles résultent à la fois de l’héritage naturel lié aux zones lacustres et dépressions de la presqu’île du Cap-Vert, de la sécheresse des années 1970 qui a entraîné un exode rural massif, mais aussi d’une urbanisation rapide et non planifiée ayant fragilisé les équilibres hydrologiques. À cela s’ajoutent la pollution des nappes, l’abandon des anciennes stations de pompage, l’occupation anarchique des zones inondables, et l’insuffisance du réseau d’assainissement, incapable de répondre à la croissance démographique et à la densité urbaine actuelle. Ces dynamiques multifactorielles, conjuguées à une gouvernance territoriale souvent fragmentée, expliquent l’ampleur des inondations qui affectent aujourd’hui la région dakaroise. Leur analyse approfondie permet d’établir un diagnostic clair des causes structurelles, condition indispensable à la définition de réponses intégrées et durables.
-Genèse des zones lacustres et rôle des dépressions naturelles
Le site de Dakar est marqué par des dépressions lacustres et zones humides (Niayes, Technopole, Yoff, Pikine, Mbeubeuss), qui constituaient des zones de régulation hydrologique et des réserves agricoles (Fall, 2011). L’urbanisation progressive de ces espaces, souvent non aedificandi, a fragilisé leur fonction écologique et accru la vulnérabilité aux inondations.
-Sécheresse des années 1970 et exode rural
La sécheresse prolongée des années 1970 a provoqué un exode rural massif vers Dakar (Touré, 2005). Les nouveaux arrivants, faute de foncier disponible et de planification urbaine adéquate, se sont installés sur des zones inondables, accentuant les risques hydrologiques.
-Pollution des nappes et abandon des stations de pompage
Jusqu’aux années 1980, l’approvisionnement en eau reposait en partie sur des stations de pompage locales. Celles-ci furent progressivement abandonnées en raison de la pollution des nappes phréatiques, causée par les fosses perdues non étanches, les dépôts d’ordures dans les lacs (cas de Mbeubeuss), et l’urbanisation anarchique réduisant les zones tampons agricoles (SDE, 2009).
-Urbanisation non contrôlée et lotissement des zones de captage
À partir des années 1990 à nos jours, l’urbanisation s’est accélérée avec le lotissement de la zone de captage des eaux, de la foire (CICES) et de la cité Mbakiou Faye, ainsi que l’aménagement d’une grande partie de l’ancien aéroport de Dakar. Ces opérations ont créé de nouvelles zones inondables (Ngor, Yoff, Ouest Foire, etc.), aggravant la vulnérabilité urbaine (Sy, 2017).
-Insuffisance du réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement, conçu pour une population bien moindre, ne peut supporter la densité actuelle. Cette inadéquation engendre un décor urbain insalubre : stagnation des eaux usées, débordement des fosses, dépôts sauvages et pollution chronique (ONAS, 2018).
– Problème généralisé au Sénégal
Des villes comme Diourbel, Touba ou Kaolack connaissent des problèmes similaires : urbanisation rapide, absence d’assainissement préalable, et occupation anarchique des zones inondables (Diaw, 2019).
Vers une réponse intégrée aux inondations de Dakar
Les inondations récurrentes à Dakar ne sont pas seulement le fruit de phénomènes naturels, mais le résultat d’une accumulation de choix d’urbanisation non planifiés, de la défaillance des infrastructures d’assainissement et d’une faible prise en compte de la dynamique hydrologique dans la croissance urbaine. Ainsi, toute solution durable doit être systémique, c’est-à-dire associer la planification urbaine, la gestion des ressources en eau et la valorisation agricole des zones périphériques.
La réponse ne peut pas être fragmentée : elle doit s’inscrire dans une réorganisation spatiale de la métropole dakaroise, alignée sur le Plan national d’urbanisme et la Vision Horizon 2050. Cela suppose une coordination étroite entre les ministères clés, l’implication du secteur privé et une réappropriation citoyenne des enjeux territoriaux.
C’est à partir de ce cadre global que se déclinent les recommandations suivantes
- Réorganisation spatiale et planification territoriale : Élaborer une planification intersectorielle de Dakar sous la coordination du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT). Délocaliser les populations vivant en zones inondables dans le cadre du Programme des 100 000 logements. Respecter la morphologie naturelle de Dakar dans toute future planification.
2. Gestion durable de l’eau et assainissement : Réhabiliter les bassins de rétention et zones humides. Développer un réseau intégré d’assainissement adapté à la densité urbaine. Introduire des solutions fondées sur la nature (forêts urbaines, infiltration contrôlée, trames vertes).
3. Agriculture et souveraineté alimentaire : Élaborer un schéma directeur agricole pour Dakar, Thiès et Mbour, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture. Protéger les Niayes comme zones agricoles stratégiques. Développer l’agriculture urbaine et périurbaine comme barrière contre l’urbanisation anarchique.
4. Gouvernance intégrée et secteur privé : Créer une cellule interministérielle impliquant le MUCTAT, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de l’Agriculture, les collectivités territoriales, le secteur privé et les PTF. Promouvoir les PPP pour la gestion de l’eau et la valorisation des déchets.
9. Conclusion
Les inondations à Dakar ne sont pas une fatalité mais le résultat d’un déficit de planification, d’une urbanisation anarchique et d’un abandon progressif des équilibres hydrologiques naturels. La solution exige une réorganisation spatiale planifiée, intégrée dans le Plan National d’Urbanisme et la stratégie Horizon 2050, associant urbanisme, hydraulique et agriculture.
Bibliographie
ANSD (2023). Rapport annuel sur la population urbaine. Dakar.
Diaw, A. (2019). Urbanisation et vulnérabilité aux inondations au Sénégal. UCAD.
Fall, A. (2011). Hydrologie urbaine et zones humides de Dakar. IFAN.
ONAS (2018). Rapport sur l’assainissement urbain à Dakar. Ministère de l’Hydraulique.
SDE (2009). État des ressources en eau dans la région de Dakar. Dakar.
Sy, I. (2017). Urbanisation et risques hydrologiques dans l’agglomération dakaroise. Mémoire de Master, UCAD.
Touré, M. (2005). La sécheresse et l’exode rural au Sénégal. Dakar : L’Harmattan.
République du Sénégal (2020). Code de l’Urbanisme. Ministère de l’Urbanisme.
République du Sénégal (2013). Code Général des Collectivités Territoriales. Dakar.
République du Sénégal (2021). Stratégie Horizon 2050. Dakar.
Selbe Ndiemou Diouf
Ingénieur en Aménagement du territoire, Environnement et Gestion en travaux de Développement Urbain
Géographe / Urbaniste / Spécialisation en Développement territorial et Décentralisation
Cheffe du bureau Information Territoriale /DITC
A la Direction de la Promotion du Développement Territorial